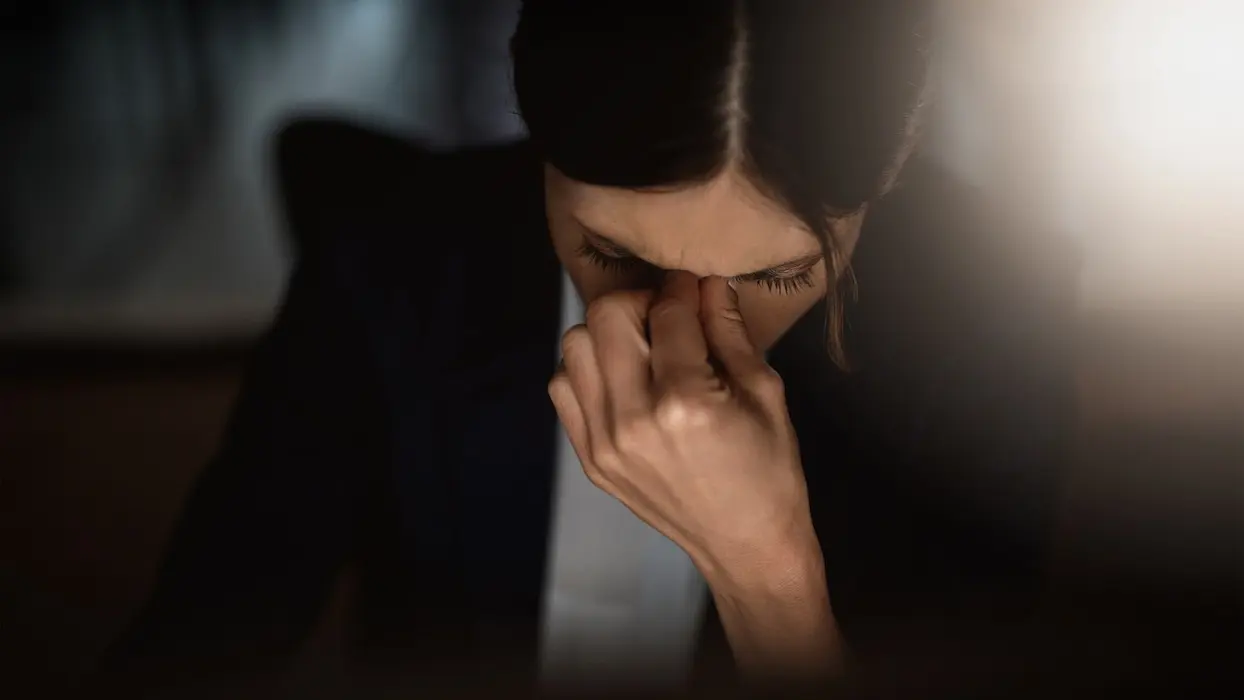7 heures du matin. “Ma chérie réveille-toi, mais qu’est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu as dormi sur le canapé ?
– Ben en fait non. Je n’ai pas dormi, enfin si là je crois que j’ai dormi un peu, mais j’ai pensé à ma préz toute la nuit. Tu sais je présente la V5 aujourd’hui à Marie, et je dois la présenter à la directrice marketing vendredi. Mais je suis crevée… Je suis tellement crevée, et puis j’ai encore envie de vomir…”
À voir aussi sur Konbini
La veille, après m’être couchée vers 1 h 30, la boule au ventre, ma nuit avait ressemblé à une sorte de compte à rebours pendant lequel je n’avais quasiment pas fermé l’œil.
J’avais passé, ce soir-là encore, plusieurs heures sur mon ordinateur à retravailler “ma préz” sur le “data-catching” pour la énième fois avant mon “one to one” du lendemain avec Marie, ma cheffe. Et toute la nuit j’y avais pensé, repensé, je m’étais tournée et retournée dans le lit, et j’avais fini par aller sur le canapé pour ne pas réveiller mon compagnon.
Je n’avais pas plus réussi à fermer l’œil en ayant changé de pièce, car j’angoissais énormément avant mon rendez-vous du lendemain : j’avais peur d’entendre encore une fois que ce que j’avais fait ne convenait pas, et me demandais ce qu’il fallait changer sur mes slides pour que ça soit parfait.
Finalement, ce matin-là, après avoir longuement hésité et beaucoup pleuré, j’ai décidé d’aller chez le médecin plutôt que d’aller travailler. Il m’a arrêtée une première fois quinze jours, arrêt qu’il a par la suite renouvelé une fois. Un mois au total d’arrêt pour surmenage, ou “burn-out”, comme on dit. La première définition que l’on trouve en tapant “burn-out” sur Google, c’est : “état de fatigue intense et de grande détresse causé par le stress au travail”.
Ça ressemblait en effet beaucoup à ce que je vivais depuis un peu moins d’un an.
Deux ans auparavant, j’avais rejoint cette entreprise leader sur son marché, et ça avait été pour moi un aboutissement, un rêve qui se réalisait en quelque sorte. J’y avais fait un stage quand j’étais étudiante, et j’avais toujours rêvé d’y revenir. La culture d’entreprise était très forte, et le nom faisait rêver. Je ressentais une immense fierté à chaque fois que je disais que j’y travaillais.
“Et toi Élodie, tu fais quoi dans la vie ?
– Moi, je suis responsable CRM (un acronyme barbare qui veut dire customer relationship management, la fidélisation client en gros) chez XX.
– Oh c’est vrai ? C’est génial ! Ça a l’air top comme boîte ! Les pubs sont superbes, ça doit être canon de bosser au marketing là-bas !“
J’étais manager, avec une petite équipe, ce qui était mon souhait après ma précédente expérience où j’avais eu une grosse équipe à manager. Je travaillais à l’international, et au quotidien, mon job, c’était d’aider les équipes des bureaux des pays que l’on appelait les “nouveaux marchés” à développer leurs techniques de fidélisation clients. J’avais la chance d’échanger au quotidien et de rendre visite de temps en temps à mes collègues de Russie, d’Afrique du Sud, d’Italie, d’Israël…
Sur le papier, c’était parfait, intéressant, enrichissant, diversifié… Dans les faits, ce n’était pas si simple, pour moi en tout cas, et j’ai eu du mal à implémenter les choses que j’aurais voulues. Et au moment de la réorganisation, j’ai été rétrogradée : suppression de collaborateurs à manager et donc perte de responsabilités pour revenir à un travail très opérationnel.
J’ai accepté cette décision car je la trouvais légitime du point de vue de l’entreprise : j’avais conscience de ne pas avoir été suffisamment à la hauteur. Je n’avais pas su implémenter de profonds changements ni apporter les améliorations attendues. Alors j’ai accepté beaucoup, beaucoup de choses, qu’avec le recul je n’aurais jamais dû accepter, car je voulais par-dessus tout rester dans cette entreprise, toute ma vie, et surtout montrer de quoi j’étais capable.
Chaque jour, l’impression que ce que je faisais était insuffisant
Lors de mon entretien de fin d’année avec ma nouvelle manager, une personne plus jeune que moi, anciennement cheffe de projet et qui venait d’avoir une promotion, on m’a fait comprendre que mes résultats étaient très en deçà de ce qu’on attendait de moi, de mon “expertise” et de ma “séniorité” et que j’allais devoir faire mes preuves sous un mois, avec cette fameuse présentation.
Ce travail a pris une ampleur complètement démesurée : j’avais l’impression d’être en période d’essai, de devoir faire mes preuves à chaque instant, que mes douze années d’expérience allaient être jugées sur ce travail et que ma vie en dépendait : c’était ma dernière chance. J’y passais mes week-ends, mes soirées, tout en essayant de continuer à gérer le quotidien : le soutien de mes collègues à l’étranger qui faisaient encore appel à moi tous les jours, même si je n’étais plus manager, et la gestion de mes nouvelles missions ultra-opérationnelles qui me prenaient beaucoup de temps…
Je me souviens entre autres avoir passé deux heures sur mon ordinateur lors d’un week-end en amoureux dans un endroit de rêve car j’avais posé mon lundi, et qu’il fallait préparer “des slides récap’” pour une réunion ayant lieu le mardi matin (slides qui ne seront au final pas visionnées par manque de temps), d’une crise de larmes en plein dîner de Saint-Valentin, sans compter les soirées entre copines que j’ai manquées.
Le plus marquant était ce sentiment de culpabilité que j’éprouvais quand je ne travaillais pas le week-end et que j’essayais de me reposer, de voir mes amis ou de passer un moment avec mon compagnon.
Chaque jour, à chaque minute, j’avais le sentiment que ce que je faisais était insuffisant, ou tout au plus “bien, mais pas top”. Je vivais très mal de ne même plus être conviée à des réunions auxquelles auparavant je devais absolument participer et d’entendre “t’inquiète je te débrieferai !”, d’être devenue la collègue de mes anciens collaborateurs, de rédiger des mails ou des comptes rendus pour ma responsable qui se contentait de les signer et de les transférer alors que j’avais fait tout le boulot.
J’avais la boule au ventre tout le temps, je ne me reposais plus jamais – et quand je tentais de le faire, je culpabilisais de ne pas travailler. Je vivais pour mon travail tout en étant persuadée de ne JAMAIS faire ce qu’il fallait.
Pendant ce mois d’arrêt, je me suis rendu compte que je ne vivais plus pour moi, mais pour mon travail, pour mon entreprise. Ce job avait pris une importance telle qu’il avait pris toute la place, sans que je m’en rende compte. J’avais accepté des choses inacceptables et avec le recul, je ne comprends même pas comment j’ai pu laisser faire ça. J’ai donc pris la décision de redevenir heureuse et de vivre pour moi.
Quand je suis retournée au bureau, j’ai annoncé que je voulais partir et j’ai demandé une rupture conventionnelle. Je ne savais pas ce que j’allais faire après, et je ne sais toujours pas, même si des pistes commencent à émerger. L’urgence était de me sauver !
Je n’ai pas encore totalement digéré cette expérience qui date de bientôt un an. Je sais juste que cette vie n’est plus pour moi et qu’aucune entreprise, aussi prestigieuse soit-elle, ne doit laisser accepter ce genre de débordements. Aucun boulot, aussi bien payé soit-il, ne doit faire qu’on s’oublie complètement, et qu’on en arrive à culpabiliser de se reposer le week-end.
Et finalement, je n’ai jamais su ce que valait la V5 de ma “prez” sur le “data-catching”…
Élodie, 37 ans, sans emploi, Montreuil
![]() Ce témoignage provient des ateliers d’écriture menés par la ZEP (la Zone d’Expression Prioritaire), un média d’accompagnement à l’expression des jeunes de 15 à 25 ans, qui témoignent de leur quotidien comme de toute l’actualité qui les concerne.
Ce témoignage provient des ateliers d’écriture menés par la ZEP (la Zone d’Expression Prioritaire), un média d’accompagnement à l’expression des jeunes de 15 à 25 ans, qui témoignent de leur quotidien comme de toute l’actualité qui les concerne.